LE MONDE
Ce pourrait être un cauchemar de touriste américain à Paris. Mais au petit matin, il savourerait à l'hôtel, en même temps que ses croissants, la réalité retrouvée. Ann Webb, elle, ne se réveille pas. Depuis plus de trois mois, cette aide-soignante de 43 ans venue de Portland (Oregon) visiter la ville de ses rêves partage le quotidien peu enviable des SDF parisiens.
Elle en a adopté l'aspect. Regard infiniment las, dos voûté, elle porte aux pieds de gros godillots informes, à la main un sac plastique d'hypermarché. Par-dessus son manteau, elle a recouvert ses épaules de deux pulls bon marché. L'histoire sidérante que nous raconte Ann Webb devant son premier vrai repas depuis des lustres commence pourtant on ne peut plus banalement. Par une envie de vacances.
Quoi de plus classique pour une Américaine de milieu modeste, qui travaille dur, depuis toujours ? A 14 ans, elle donne déjà des coups de main à sa grand-mère, infirmière à domicile. Plus tard, elle décroche un diplôme d'aide-soignante. Et commence à enchaîner les journées de douze heures, à jongler avec deux emplois. Elle se marie, perd un enfant d'une leucémie, divorce, doit se débrouiller avec un seul salaire, vit dans une chambre qu'elle loue. Elle ne supporte plus, surtout, toute cette violence qui l'environne, "tous ces gens qui portent des couteaux, ou des pistolets, et s'en servent. Notamment ceux qui reviennent d'Irak"…
LE VOL ANNULÉ
Durant des mois, dollar après dollar, Ann Webb économise pour s'offrir, en automne, quand les tarifs se font plus doux, une échappée belle vers l'Europe. Un billet d'avion pour l'Espagne, une semaine dans une résidence de tourisme à Marbella. Se fiant aux tarifs repérés sur Internet, elle met de côté 900 dollars pour le billet retour. Lui resteront 1 000 dollars pour vivre, faire un saut à Madrid et Barcelone, puis gagner Paris en train et y rester quelques jours. A La Nouvelle-Orléans, qu'elle a un temps habitée, et appréciée, on lui a toujours dit qu'il y avait une vraie filiation entre la ville des Lumières et l'ancienne capitale de la Louisiane française. Que quiconque aimait l'une aimerait l'autre.
Venant d'Espagne, donc, Ann Webb débarque à Paris, gare d'Austerlitz, le 10 novembre 2008. Est-ce l'élection de Barak Obama ? Elle trouve les Français bien plus cordiaux que les Espagnols. "Le Louvre, la tour Eiffel, de toute beauté, et les gens amicaux… C'était exactement comme je l'avais imaginé." La suite était moins prévisible. Ann commence à être à cours d'argent, en dehors du petit pécule prévu pour le billet retour. Le 11 novembre, dans un cybercafé, elle déniche sur le site d'une de ces grosses agences en ligne qui dégriffent les billets d'avion un Paris-Portland à 549 dollars. Départ prévu le 17. Mais le 14, elle reçoit un mail du voyagiste. Les pilotes d'Air France – qui s'inquiètent de la nouvelle possibilité de travailler jusqu'à 65 ans – sont en grève. Son vol est annulé.
Ann Webb n'a pas souscrit l'assurance à 50 dollars qui lui permettait de se prémunir contre ce genre d'aléas. Le prix des autres billets proposés a doublé. Elle n'a plus assez d'argent pour rentrer chez elle. "Mon cœur s'est arrêté", raconte-t-elle. Son regard, jusque-là d'une grande intensité, s'embue. Elle semble revivre la douleur de ce moment. "Je savais que j'étais coincée à Paris. Presque sans un sou. Dans un pays dont je ne parlais pas la langue. J'étais terrorisée."
Mais l'Américaine espère encore. Une grève, cela ne peut pas durer bien longtemps ! Le prix des billets va baisser. Il n'en est rien. Le temps passe, les nuits d'hôtel coûtent. Sa carte visa prépayée se vide. Ann, soudain, se tait. Avoue sa crainte de "passer pour l'Américaine un peu gourde qui n'est jamais sortie de chez elle". Ce qui n'est pas totalement faux, admet-elle dans la foulée. "C'est vrai que j'étais sans doute un peu naïve. Je n'avais certainement pas assez économisé avant de partir…"
Elle s'offre avec ses derniers deniers deux nuits d'hôtel bon marché, et tente de se calmer, de réfléchir. Elle n'a pas d'économies au pays. Ses parents sont décédés. Elle n'a plus de contact avec son ex-conjoint. Ses rares amies sont fauchées (l'une d'entre elles, une ancienne colocataire, lui envoie tout de même 70 euros). Sa voiture est une épave dont elle ne tirera rien à la vente. Dans l'agence d'infirmières et d'aides-soignantes qui l'emploie, on ne supporte pas d'entendre parler de problèmes personnels. Inutile de les solliciter…
Reste le consulat américain. Contrôles drastiques de sécurité, ticket, file d'attente, enfin une fonctionnaire derrière sa vitre. Fort peu aimable. Ann, à moitié en pleurs, tente de lui expliquer sa situation. Elle veut rentrer, elle n'a plus d'argent. Dans l'affolement, elle croit comprendre : "Maintenant que vous êtes en France, il faut aller à l'ambassade de France. Personne suivante." A la sortie du consulat, elle interroge le premier passant. Où se trouve l'ambassade de France la plus proche ? Il éclate de rire.
"J'étais en état de choc. Traumatisée. L'ambassade ne pouvait rien pour moi ! Toute la nuit suivante, j'ai marché." Elle erre dans ce même Paris des touristes – tour Eiffel, Louvre, rue de Rivoli – qu'elle a découvert en des temps qui semblent déjà lointains. Elle se nourrit d'un sandwich abandonné, d'une orange qui traîne. "J'ai vite compris qu'il fallait marcher. Sinon, moi qui suis une femme, qui ai les cheveux blonds, je risquais d'être attaquée. Dès que je m'arrêtais, il y avait des hommes, des SDF eux aussi, qui venaient vers moi… Je me sentais vulnérable."
EN PLEIN FROID
Epuisée, elle échoue sur un banc près de la Seine, au pied de la tour Eiffel. De gros rats sortent d'un buisson. "A une époque, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique. Je prenais soin des rats. A la fin des expériences, j'étais incapable de les tuer. Je demandais à les ramener à la maison." Ils lui montrent la voie, pense-t-elle. Une cachette qui la soustrait au regard des hommes. Plusieurs nuits d'affilée, elle dormira dans ces buissons.
Deux semaines à la rue, en plein froid. L'aide-soignante commence à repérer les distributions gratuites de soupe. Partout, elle tente d'expliquer qu'elle veut repartir aux Etats-Unis. Mais avec ses trois mots de français, et son fort accent américain, on ne la comprend guère. Elle partage la tente d'une Tchèque. Est hébergée par une "dame asiatique" qui a connu, elle aussi, la misère, mais lui demande de partir lorsque son mari rentre de voyage.
Des compères d'infortune plus "gentlemen" que d'autres, "beaucoup de messieurs arabes", lui confient quelques trucs pour survivre dans la rue. Superposer les couches de vêtements et de chaussettes, porter gants et bonnet, avoir des chaussettes de rechange dans un petit sac régulièrement renouvelé, ne pas être repéré comme SDF. Ils lui indiquent les stations de métro ouvertes la nuit, les bouches d'aération, dans le sol, d'où sort l'air chaud… Les endroits "où se procurer un duvet, où obtenir des vêtements, où prendre une douche, où lire ses mails…", énumère l'Américaine, bluffée de tant d'aide possible. "J'ai même pu avoir une coupe de cheveux et une couleur gratuite ! Aux Etats-Unis, ça faisait dix ans que ça ne m'était pas arrivé. J'ai dû devenir sans-abri à Paris pour ça !", sourit-elle devant nous pour la première fois.
Les SDF, Ann Webb les découvre fort nombreux à Paris. Beaucoup plus qu'elle ne l'aurait imaginé. "Avec le secours qu'ils reçoivent, on ne peut pas deviner qu'ils sont sans domicile, ils passent inaperçus. Moi-même, un jour où j'étais assise sur un banc dans un parc, un Américain m'a demandé comment on repérait les pharmacies en France. Je lui ai parlé des croix vertes. Il a pensé que j'étais une touriste. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité."
Ses souvenirs de la rue ne sont pas roses pour autant. Loin de là. Gare de l'Est, un groupe d'Afghans lui propose de dormir dans un endroit chaud… si elle accepte de coucher avec deux d'entre eux. "Cela dit, aux Etats-Unis, on m'aurait entraînée de force avec un couteau. Là, j'ai dit non, et ils m'ont laissée partir."
SOUPE DE RUE
Dans une association qui la domicilie, on lui demande ce qu'elle pense de Bush. Rien de bon. Sans doute habitué à d'autres profils de SDF, un bénévole lui suggère alors de faire une demande d'asile. Ann nous montre le formulaire de la Préfecture de police de Paris, qu'elle s'apprêtait à remplir, avant d'en comprendre la teneur exacte et de réaliser que cela ferait d'elle une traître à la nation américaine.
Il y a surtout ce jour dantesque où des hommes tentent de lui arracher son pantalon. Elle s'échappe. Mais doit traverser tout Paris en sous-vêtements sous son manteau pour en obtenir un autre auprès d'une association. Ce soir-là, épuisée, à bout de nerfs, elle fait la queue pour une soupe de rue. Quand son tour arrive, il n'y en a plus. Elle s'effondre en larmes. On la console, on lui trouve des restes. "Je me suis dit que si je m'en sortais, je viendrais les aider. Aux Etats-Unis, j'étais bénévole à la Croix-Rouge, j'aidais les gens à construire leur abri temporaire lors des inondations."
Un sans-abri ("un Cubain qui voulait m'épouser, attiré par mon passeport") la guide jusque chez Emmaüs. Elle découvre les hébergements de nuit, se sent enfin "à peu près en sécurité". Mais impossible de réserver une chambre pour le lendemain, il faut repasser par le 115, le numéro d'urgence pour les SDF. Au téléphone, elle a bien du mal à raconter son parcours abracadabrant, à convaincre qu'elle vit dans le dénuement le plus total. "Vous êtes une touriste américaine, s'entend-elle répondre invariablement. Nous n'aidons pas les touristes américains. Vous devriez retourner aux Etats-Unis." Un certain Mohammed, lui aussi à la rue, lui explique qu'elle y a droit comme tout un chacun, qu'elle doit insister, demander un responsable. Quarante minutes de palabres à chaque fois. "Epuisant."
Début janvier, Ann Webb peut enfin cesser de marcher toute la journée dans la rue. Une place s'est libérée dans un centre Emmaüs d'hébergement et de réinsertion sociale, ouvert 24 heures sur 24. Celia Morgant, travailleuse sociale, se souvient d'avoir vu arriver une personne "dans une grande fatigue physique et morale, comme c'est le cas de tous ceux qui viennent de la rue". La première Américaine jamais accueillie. Qui, là encore, peine à se faire comprendre.
Ann Webb nous montre la chambre austère qu'elle partage avec une autre femme de la rue. Un lavabo, deux lits d'une place, deux minuscules penderies. En pleine journée, sa compagne de chambrée dort, toute habillée, sur son lit. Elle ronfle comme un sonneur, "mais elle est gentille", soupire l'Américaine. Les vêtements de cette dame forment, au pied de son lit, un gros tas sur lequel trône un chariot. Ann Webb, elle, peut toujours faire entrer ses affaires dans la petite valise qu'elle avait au départ.
DIALOGUE DE SOURDS
Lorsque Le Monde 2 contacte l'ambassade américaine à Paris, c'est la stupéfaction. Elizabeth Gourlay, consule, nous reçoit très rapidement. "Nous n'étions pas au courant de son histoire. Nous ne laisserions jamais une citoyenne américaine, incapable de rentrer chez elle, à la rue en France, surtout dans la période de Thanksgiving puis de Noël !" L'histoire extraordinaire d'Ann Webb démarre par une incongruité, dont on s'étonne à l'ambassade : exemptée de visa puisqu'elle partait pour moins de 90 jours, la touriste américaine n'aurait jamais dû être autorisée à prendre l'avion pour l'Europe sans apporter la preuve qu'elle détenait un billet retour.
Autre source d'interrogations : son passage au consulat. Que s'est-il donc passé le jour où Ann Webb s'est présentée ? Dans son état de panique, n'a-t-elle rien compris de ce que la guichetière lui disait ? S'est-elle par erreur dirigée du côté des demandes de visa pour les Français plutôt que du côté des informations pour les citoyens américains, enclenchant un dialogue de sourds avec la fonctionnaire de l'ambassade ?
Normalement, elle aurait dû être rapatriée dans les trois ou quatre jours ouvrables. Une procédure banale, mise en œuvre en moyenne trois fois par mois, et jusque deux fois par jour au mois d'août, "le plus souvent pour des gens venus avec les Miles accumulés sur leur carte d'abonné d'une compagnie aérienne, mais qui n'ont pas prévu le budget suffisant pour vivre en France". Si aucun proche contacté ne peut aider, l'Etat américain avance le prix du billet, gardant le passeport de l'impécunieux jusqu'au remboursement. Par notre entremise, Ann Webb est invitée à se présenter au consulat dès le lendemain, 9 heures.
"ICI, MÊME LES SDF ONT UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE"
Elle n'en revient pas. "Evidemment, maintenant je me dis que c'est évident : j'aurais dû insister auprès de l'ambassade. Mais on m'avait éconduite. C'était sans appel. Je pensais qu'ils ne pouvaient rien pour moi." S'y rendra-t-elle le lendemain ? "C'est trop tard, maintenant", tranche-t-elle, à notre grande surprise. "Aux Etats-Unis, j'ai tout perdu. Ma chambre est relouée, mon job a dû être confié à quelqu'un d'autre puisque je ne suis pas rentrée à la date prévue, ma voiture est partie à la fourrière. Je serai une 'homeless', une sans-abri aussi là-bas. Combien de temps me faudra-t-il pour économiser de quoi rembourser le billet d'avion ?"
Son destin, pense-t-elle maintenant, est peut-être de rester en France. "Je me dis que je n'ai pas pu vivre tout ça pour rien. Qu'il doit y avoir une raison." L'expérience de la rue a bouleversé sa "vision de la vie", et l'a rendue "humble". "Je sais maintenant qu'on est tous les mêmes." Elle a côtoyé des Algériens, des Russes, des Ukrainiens, des Africains, des Afghans… Entre deux pleurs, elle en rit. "Moi qui ai toujours voulu connaître différentes cultures !"
Ann Webb rêve désormais de trouver un travail, ici, en France. Même si c'est compliqué, qu'il lui faut apprendre la langue, faire des pieds et des mains pour obtenir des papiers. "Je suis tellement impressionnée par l'absence de violence. Je ne vois des policiers que pour garder la tour Eiffel, je ne croise personne avec un couteau. Je peux laisser mon sac par terre dans un magasin et le retrouver ! L'Amérique, croyez-moi, ce n'est pas ce que les gens pensent ici. Le coût de la vie est si élevé qu'il faut travailler très dur pour tout. Vous n'avez pas idée… A partir de Bush, cela n'a plus été comme sous Clinton. Tout le monde a deux boulots pour nourrir ses enfants. Le 'Land of opportunity', c'est fini !"
Homeless aux Etats-Unis ? Elle n'y survivrait pas, nous assure-t-elle. Tant qu'à être sans abri, elle préfère l'être en France. "Ici, même les SDF ont une meilleure qualité de vie."
---------
Un peu couillonne Miss Webb mais ça ferait un bon film.
Some facts: France has about 100,000 homeless people, the U.S. has about 740,000. Similar numbers per capita.
jeudi 26 février 2009
lundi 23 février 2009
Man on wire

Oscars 2009 : Lot de consolation pour la France
"Le Funambule" ("Man on wire" en anglais) a reçu l'Oscar 2009 du "Meilleur film documentaire". Dirigé par le Britannique James Marsh, le film relate un exploit fou du Français Philippe Petit. En 1974, ce dernier avait marché entre les tours jumelles du World Trade Center.
http://documentaryheaven.com/2009/08/man-on-wire-2008/
samedi 14 février 2009
Mayday

Mayday est une expression utilisée internationalement dans les communications radio-téléphoniques pour signaler qu'un avion ou qu'un bateau est en détresse. Son usage est prescrit depuis l'«International Radio Telegraph Convention» de 1927. Le mot est une déformation volontaire anglophone de la phrase française : « venez m'aider ! ».
Wikipédia
jeudi 12 février 2009
"L'Obama"
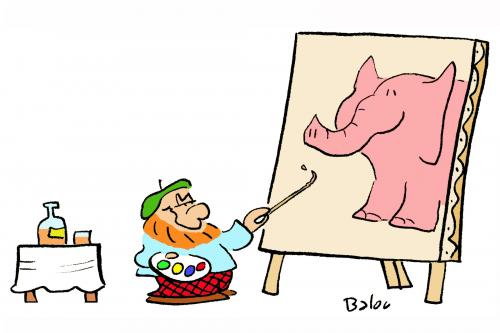
« Un mélange d’herbes vient d’être interdit en Allemagne car il a les mêmes effets que le haschich. Un autre produit venu d’Amérique, “l’obama”, a aussi des effets euphorisants ! Est-ce une drogue ? Certains disent non car les dealers ne le vendent pas ; il est diffusé par les télévisions et les mass médias. Il pénètre dans le corps sans seringue, par les yeux et les oreilles. Deux millions d’Américains à Washington en auraient déjà consommé. Il vous fait voir le monde en rose : vous allez croire que les tempêtes vont disparaître, que la crise financière va cesser et que les trains seront à l’heure ! Et même le Moyen-Orient paraîtra sous les traits d’un éléphant rose ! Le produit chimique de l’OBAMA qui crée cette réaction s’appelle un “charisme”, lequel a déjà fait des ravages en Allemagne par le passé ! Le gouvernement allemand a décidé de lutter contre le charisme grâce à Madame Merkel et au président Kohler, qui sont des anticharismes puissants ! » (SOURCE : « Die Welt am Sonntag », éditorial du 25/01/09, trad. Y.B.)
Tourner à Hollywood ?

Pour un cinéaste français, l'usine à rêves est une forteresse aux codes mystérieux. Pourtant, quelques téméraires tentent l'aventure, comme Bertrand Tavernier ou Alexandre Aja (“Mirrors”). Avec plus ou moins de fortune…
Tourner à Hollywood ? Ce n'est plus le vieux mythe de la conquête d'un marché ultra-protectionniste, mais bien une réalité : chaque année, plusieurs cinéastes français tentent l'aventure d'un film américain. Il peut s'agir d'une commande venant d'une major, puisque le système de production hollywoodien est sans cesse en quête de nouveaux talents ; ou d'un projet plus personnel nourri d'une assidue cinéphilie transatlantique. Il n'est pas rare pourtant que l'aventure soit tumultueuse. Pour un Michel Gondry, à l'aise des deux côtés de l'Atlantique - et récompensé d'un oscar du meilleur scénario pour Eternal Sunshine of the spotless mind -, combien de cinéastes ont gardé un souvenir mitigé d'une expérience de travail radicalement différente ?
Au printemps 2007, Bertrand Tavernier s'installe en Louisiane pour y réaliser Dans la brume électrique. Cet amoureux du cinéma américain a déjà connu deux expériences outre-Atlantique : un documentaire, Mississippi Blues, et une fiction entre New York et Paris, Autour de minuit, « tournée avec une équipe française, comme un film français ». Cette fois-ci, l'envie d'un vrai film américain - quoique aux deux tiers financé par la France - est née de la découverte des polars de James Lee Burke, et de son héros récurrent, le détective de La Nouvelle-Orléans Dave Robicheaux. « Je ne voyais que Tommy Lee Jones pour le rôle, dit Tavernier, et il fallait s'y mettre vite, avant que l'acteur ne soit trop âgé. » Du coup, en quête d'un producteur local, Tavernier choisit celui de Trois Enterrements, Michael Fitzgerald, qui connaît bien la star. « Quelqu'un d'intelligent, de très cultivé, qui a travaillé avec John Huston, mais avec qui j'ai finalement eu des désaccords sur la vision du film. » Les divergences portent sur la forme du récit, jugée trop complexe pour le grand public américain. Après plusieurs mois de discussion, retardé encore par la grève des scénaristes (une voix off doit être écrite), Tavernier obtient la possibilité d'exploiter, hors des Etats-Unis, son propre montage. Cette version, présentée il y a quelques jours au festival de Berlin, sortira en France le 8 avril, tandis qu'aux Etats-Unis Dans la brume électrique passera directement par la case DVD.
“Tommy Lee Jones m'avait prévenu :
‘Relisez bien le script, parce que s'il est indiqué
qu'à l'arrière-plan il y a deux buissons,
il y aura deux buissons, pas plus, pas moins.’”
Imbroglio mis à part, le cinéaste a trouvé les méthodes de travail déconcertantes. « Les techniciens sont formidables, mais il n'y a pas cette notion très française d'équipe soudée par une aventure collective. Et puis il y a des rigidités à tous les stades, des règles bizarres. » En vrac, l'obligation de bloquer la moitié du salaire des acteurs avant accord, « d'où des agios que ma société a du mal à payer », une équipe lourde « avec plein de gens dont on ne sait pas très bien à quoi ils servent... », l'omniprésence des agents et des avocats, l'irruption sur le plateau d'un monteur qui contrôle en permanence le travail du metteur en scène, etc. Ce n'est pas toujours propice à l'inspiration : « Avant le tournage, Tommy Lee m'avait prévenu : "Relisez bien le script, parce que s'il est indiqué qu'à l'arrière-plan il y a deux buissons, il y aura deux buissons, pas plus, pas moins." Moi, je ne lis pas trop les descriptions, je me dis que si on trouve un lieu différent, plus approprié, on changera trois mots. Ça ne se passe pas comme ça... » Tavernier prépare déjà son prochain film... en France.
D'autres cinéastes n'ont simplement pas le choix de ne pas s'exiler... « Quand on a envie de tourner des films d'horreur, la France n'est pas le bon pays, explique David Moreau. Financée par les télés, notre industrie ne veut pas en produire, et de toute façon le public français ira d'abord voir un film d'horreur américain. » Pourquoi alors se refuser à qui vous tend les bras ? Début 2006, David Moreau a coréalisé avec Xavier Palud un petit film d'angoisse en français, Ils, tourné avec un budget dérisoire, mais qui tape dans l'oeil des agents et producteurs américains. « Après une projection au festival de Berlin, plusieurs grosses agences nous ont appelés. Le choc était violent : en France, on se bat pour rencontrer des décideurs, et là, ils voulaient tous nous voir... »
Début du conte de fées. Le tandem choisit un agent, se paye un billet pour Los Angeles, et fait le tour de l'industrie. « On avait quatre-vingts rendez-vous à assurer en quinze jours. Les studios nous envoyaient des scénarios, qu'on finissait de lire sur le parking, dix minutes avant le meeting. Et les types nous flattaient : "Vous êtes les nouveaux Hitchcock !" » Moreau et Palud atterrissent chez la toute-puissante Paula Wagner, l'agent qui a fait le succès de Tom Cruise, devenue productrice à la Paramount : à la clé, le remake d'un film d'horreur asiatique, The Eye, projet en attente depuis plusieurs années. Rencontre avec le pouvoir : « C'était dans l'ancien bureau d'Howard Hughes, raconte David Moreau. Je revois la scène : Paula Wagner nous attendait, à travers les persiennes le soleil couchant faisait briller sa chevelure. Elle nous a regardés un peu bizarrement : elle était en Prada de la tête aux pieds, nous, on était sapés comme des ploucs. »
Le rendez-vous débouche sur un accord. Moreau et Palud doivent alors se présenter devant le syndicat des réalisateurs américains, pour obtenir une dérogation. « Une grande salle, quarante personnes, dont Michael Mann, Robert Zemeckis, Cameron Crowe. Impressionnant. Un type à casquette, visage baissé, examine notre dossier : "Alors, comme ça, vous voulez réaliser à deux ? Il relève la tête, c'était Steven Spielberg." » Suivra un tournage plutôt idyllique, avec une jeune star motivée, Jessica Alba - « Elle n'en revenait pas qu'on ait envie de discuter avec elle de son rôle. Le conte de fées a pris fin au moment du montage : on n'avait pas fait le film qu'ils attendaient de nous, et ils nous ont lentement, mais sûrement, écartés du projet. » Les divergences sont esthétiques : « On avait tourné des plans en caméra subjective, où l'héroïne, qui venait de subir une greffe de cornée, voyait flou. Ils voulaient que l'image soit nette, qu'on voie bien la fille en train de dire "J'ai peur..." » Un monteur docile retourne les scènes manquantes, et le tandem est contraint de signer un film qui n'a plus grand-chose à voir avec le projet originel.
David Moreau est philosophe : « Pour un réalisateur américain, l'expérience doit être traumatisante. Nous, on peut toujours rentrer en France... » Comme l'a fait Mathieu Kassovitz, en bisbille avec sa star, Vin Diesel, et sa production, la Fox, sur Babylon A.D. Ou encore quelques jeunes espoirs de l'horreur à la française : Eric Valette, dont les deux films américains (One missed call et Hybrid) sont inédits chez nous, ou le duo Alexandre Bustillo et Julien Maury, réalisateurs de la série B gore A l'intérieur, qui ont bossé en vain sur deux projets américains. De cette génération-là, un seul a trouvé sa voie : Alexandre Aja, 30 ans, quatre films à son actif, dont deux américains, La colline a des yeux, remake d'un classique horrifique de Wes Craven, et Mirrors, avec Kiefer Sutherland. Là encore, c'est son deuxième film français, Haute Tension, qui a attiré l'attention des décideurs hollywoodiens. « Après la projection au festival de Toronto, raconte Alexandre Aja, j'ai été bombardé de scénarios. Mon scénariste et moi, nous avions l'impression d'être des enfants dans un magasin de bonbons ! Mais on s'est dit que l'important était d'écrire nous-mêmes et de participer à la production : en tant qu'auteurs, vous avez les réponses aux questions posées par les financiers, en tant que coproducteurs, vous participez aux réunions, aucune décision n'est prise sans que vous le sachiez. »
Sur chacun de ses deux films américains, le cinéaste a connu au moins « une confrontation violente, avec des menaces. J'ai tenu bon, et j'ai eu raison ». La difficulté est de savoir contre qui se battre. « Le grand problème avec le système américain, c'est qu'on n'a jamais accès à la personne qui prend les décisions : il y a un marais impénétrable de coproducteurs, producteurs associés, directeurs du marketing. Tous ont un avis divergent, et il faut trouver qui a vraiment le pouvoir. » Alexandre Aja a ainsi été obligé de se soumettre à l'épreuve des projections-tests. « J'avais peur de cette étape, je pensais que le procédé était dangereux, j'en suis moins sûr aujourd'hui. Quand vous débutez dans le cinéma, on ne vous dit pas à quel point une ligne de scénario peut devenir incompréhensible à l'image. Si trente personnes ne saisissent pas une intention, il faut penser à une nouvelle astuce de montage. Il ne faut pas être borné ! » Le succès mondial de Mirrors - plus de 80 millions de dollars de recettes - ouvre à Alexandre Aja des perspectives, toujours dans le cinéma de genre qu'il affectionne. Son prochain film sera américain et coûteux. Un film d'action, d'aventures et d'horreur en 3D : Piranha. Toute ressemblance entre les poissons carnivores et les cadres de Hollywood sera involontaire...
Et un film à 100 % financé par la France, mais qui ressemblerait comme deux gouttes d'eau à un film américain ? Avec Et après, thriller romantique surnaturel tourné entre New York et le désert du Nouveau-Mexique, Gilles Bourdos dit avoir fait plutôt « un film en Amérique ». Installé à New York pour des raisons personnelles, le réalisateur de Disparus et Inquiétudes, plutôt défendus dans ces colonnes, avait envie de filmer son pays d'adoption. « Je n'imaginais pas un film à Paris, qui est une ville monochrome. L'Amérique est un pays incroyablement coloré, et visuellement très découpé : à la verticalité de New York répond l'horizontalité des grands espaces. J'ai utilisé des focales très courtes, qui donnent une grande profondeur de champ, pour que l'on sente l'espace. » Choix plastique, mais pas seulement : le filmage comme le sujet, très new age, qui joue avec l'idée de destin, modifient sensiblement la place des protagonistes, qui deviennent les jouets du récit. Comme si, dans ce cas, s'opposaient une tradition française, plutôt existentialiste, qui donne une liberté aux personnages, et une tradition américaine, plus fataliste, où l'individu n'est qu'un point - un pion ? - au cœur de quelque chose de plus grand qui lui échappe. Remplacez personnage par cinéaste ou auteur, et vous comprenez tout du système américain...
http://www.telerama.fr/cinema/hollywood-meme-pas-peur,38994.php
mardi 10 février 2009
Un tournant vers le modèle européen
L'interventionnisme étatique prôné par le président américain pour relancer l'économie rappelle les discours de son homologue français. Une idée qui ne déplaît plus à la population.
Avez-vous remarqué que le discours de Barack Obama ressemble chaque jour un peu plus à celui du président français ? Lorsqu'il déclarait, le jour de son investiture, que l'heure n'était plus à se demander si le gouvernement était trop gros ou trop petit, il semblait faire écho à l'éclectisme philosophique de Nicolas Sarkozy, qui peut prendre la défense des marchés un jour et plaider le lendemain pour les champions publics de l'industrie. En qualifiant de "honteux" et d'avide le comportement de Wall Street, le président américain n'a fait que répéter ce que les Français pensent depuis toujours et s'est inscrit dans le droit-fil des récents propos de Nicolas Sarkozy, pour qui il serait "insensé" de croire que les marchés ont toujours raison. En soutenant le principe du Buy American [acheter américain] pour que les milliards de dollars que le gouvernement investira suite au plan de relance de l'économie profitent aux entreprises nationales, l'administration Obama reprend une vieille tradition française de "patriotisme économique". Et, quand le nouveau président américain parle de limiter à 500 000 dollars [387 000 euros] le salaire des dirigeants des sociétés financières renflouées par l'Etat, il leur impose une réduction drastique que Sarkozy a déjà obtenue en janvier, lorsqu'il a convaincu les principaux banquiers français de renoncer publiquement à leurs bonus.
Le discours et les décisions de Barack Obama montrent à quel point le climat a changé au cours des derniers mois. Jusqu'à la crise financière de l'automne 2008, ce genre de plaidoyer en faveur du protectionnisme et contre les milieux d'affaires était surtout l'apanage de l'extrême gauche, et il n'était pas question de remettre en question l'idée que l'affaire de l'Amérique, c'est précisément de faire des affaires. Aujourd'hui, les spécialistes réexaminent les relations entre l'Etat et le secteur privé avec une ardeur qu'on ne leur avait pas vue depuis que Ronald Reagan avait déclaré que "le problème, c'est le gouvernement". Le plan de relance de près de 1 000 milliards de dollars actuellement examiné au Congrès s'inscrit dans le débat sur le rôle que devra désormais jouer le gouvernement fédéral dans ce qui a été pendant des décennies le domaine réservé des intérêts privés. Et, s'il n'est pas possible de savoir précisément de quoi demain sera fait, on voit néanmoins dès à présent s'esquisser les contours d'un nouvel ordre économique.
Une des conséquences les plus durables de cette crise devrait être un glissement continu vers ce qu'on pourrait appeler une forme de gouvernance à l'européenne, mêlant réglementation et paternalisme. Déjà le gouvernement monte en puissance, les projections des dépenses publiques montrent que les Etats-Unis devraient se rapprocher des moyennes européennes dans les deux ans à venir. Pour être plus précis, en l'absence de secteur privé solide (et de confiance du public envers les milieux d'affaires), le gouvernement américain va être contraint de prendre la relève et d'engager fermement des entreprises dans diverses voies. Il devra encadrer certaines industries (notamment les secteurs banquier et automobile), en privilégier d'autres, comme les énergies propres, en leur offrant des prêts et des crédits et transformer divers secteurs – comme la santé ou les retraites – en quasi-chasses gardées. Selon Ken Rogoff, économiste à Harvard, les Etats-Unis devraient se diriger vers un "système de redistribution plus centralisé, comme en Europe", avec une plus grande considération pour l'environnement, plus de réglementation et plus de protectionnisme. "Je considère les élections américaines de 2008 comme un tournant vers le modèle européen", ajoute-t-il.
L'opinion publique américaine semble elle aussi favorable à une politique permettant au gouvernement de pallier les déficiences du secteur privé. Un récent sondage Gallup révèle que les Américains n'ont jamais eu aussi peu confiance dans les institutions financières depuis 1985 (date à laquelle l'institut a commencé à leur poser la question). Aujourd'hui, 68 % des Américains souhaiteraient voir diminuer l'influence des grandes entreprises, contre 52 % en 2001. Une autre étude indique que 69 % des Américains pensent que le gouvernement devrait faire davantage pour aider les personnes les plus fragiles, alors qu'ils n'étaient que 57 % à penser la même chose en 1994. Ainsi, outre l'extension du filet de sécurité sociale, le gouvernement devra assumer davantage de responsabilités pour inciter les entreprises à réaliser des objectifs jugés bénéfiques pour l'ensemble de l'économie du pays.
Il ne s'agit donc pas d'imiter l'étatisme qui permet à certains gouvernements européens de tenir fermement les leviers de certaines entreprises privées. Mais ce n'est qu'une question de degré. Le plan de sauvetage des trois grands constructeurs automobiles de Detroit était essentiellement une mesure protectionniste prise aux dépens des fabricants étrangers, et elle n'est pas sans rappeler la décision très controversée, prise en 2004 par Nicolas Sarkozy alors qu'il était ministre des Finances, pour protéger les intérêts du géant Alstom. Stephen Roach, économiste en chef de Morgan Stanley, explique qu'une récession prolongée ne pourra que renforcer "l'intervention de l'Etat dans l'économie", notamment sous la forme du protectionnisme. "Mais l'Amérique n'est pas la France, ajoute-t-il. Nous ferons ça à notre manière – mais, quoi qu'il arrive, le gouvernement fort est de retour."
(...)
Michael Freedman et Tracy McNicoll
Newsweek
Avez-vous remarqué que le discours de Barack Obama ressemble chaque jour un peu plus à celui du président français ? Lorsqu'il déclarait, le jour de son investiture, que l'heure n'était plus à se demander si le gouvernement était trop gros ou trop petit, il semblait faire écho à l'éclectisme philosophique de Nicolas Sarkozy, qui peut prendre la défense des marchés un jour et plaider le lendemain pour les champions publics de l'industrie. En qualifiant de "honteux" et d'avide le comportement de Wall Street, le président américain n'a fait que répéter ce que les Français pensent depuis toujours et s'est inscrit dans le droit-fil des récents propos de Nicolas Sarkozy, pour qui il serait "insensé" de croire que les marchés ont toujours raison. En soutenant le principe du Buy American [acheter américain] pour que les milliards de dollars que le gouvernement investira suite au plan de relance de l'économie profitent aux entreprises nationales, l'administration Obama reprend une vieille tradition française de "patriotisme économique". Et, quand le nouveau président américain parle de limiter à 500 000 dollars [387 000 euros] le salaire des dirigeants des sociétés financières renflouées par l'Etat, il leur impose une réduction drastique que Sarkozy a déjà obtenue en janvier, lorsqu'il a convaincu les principaux banquiers français de renoncer publiquement à leurs bonus.
Le discours et les décisions de Barack Obama montrent à quel point le climat a changé au cours des derniers mois. Jusqu'à la crise financière de l'automne 2008, ce genre de plaidoyer en faveur du protectionnisme et contre les milieux d'affaires était surtout l'apanage de l'extrême gauche, et il n'était pas question de remettre en question l'idée que l'affaire de l'Amérique, c'est précisément de faire des affaires. Aujourd'hui, les spécialistes réexaminent les relations entre l'Etat et le secteur privé avec une ardeur qu'on ne leur avait pas vue depuis que Ronald Reagan avait déclaré que "le problème, c'est le gouvernement". Le plan de relance de près de 1 000 milliards de dollars actuellement examiné au Congrès s'inscrit dans le débat sur le rôle que devra désormais jouer le gouvernement fédéral dans ce qui a été pendant des décennies le domaine réservé des intérêts privés. Et, s'il n'est pas possible de savoir précisément de quoi demain sera fait, on voit néanmoins dès à présent s'esquisser les contours d'un nouvel ordre économique.
Une des conséquences les plus durables de cette crise devrait être un glissement continu vers ce qu'on pourrait appeler une forme de gouvernance à l'européenne, mêlant réglementation et paternalisme. Déjà le gouvernement monte en puissance, les projections des dépenses publiques montrent que les Etats-Unis devraient se rapprocher des moyennes européennes dans les deux ans à venir. Pour être plus précis, en l'absence de secteur privé solide (et de confiance du public envers les milieux d'affaires), le gouvernement américain va être contraint de prendre la relève et d'engager fermement des entreprises dans diverses voies. Il devra encadrer certaines industries (notamment les secteurs banquier et automobile), en privilégier d'autres, comme les énergies propres, en leur offrant des prêts et des crédits et transformer divers secteurs – comme la santé ou les retraites – en quasi-chasses gardées. Selon Ken Rogoff, économiste à Harvard, les Etats-Unis devraient se diriger vers un "système de redistribution plus centralisé, comme en Europe", avec une plus grande considération pour l'environnement, plus de réglementation et plus de protectionnisme. "Je considère les élections américaines de 2008 comme un tournant vers le modèle européen", ajoute-t-il.
L'opinion publique américaine semble elle aussi favorable à une politique permettant au gouvernement de pallier les déficiences du secteur privé. Un récent sondage Gallup révèle que les Américains n'ont jamais eu aussi peu confiance dans les institutions financières depuis 1985 (date à laquelle l'institut a commencé à leur poser la question). Aujourd'hui, 68 % des Américains souhaiteraient voir diminuer l'influence des grandes entreprises, contre 52 % en 2001. Une autre étude indique que 69 % des Américains pensent que le gouvernement devrait faire davantage pour aider les personnes les plus fragiles, alors qu'ils n'étaient que 57 % à penser la même chose en 1994. Ainsi, outre l'extension du filet de sécurité sociale, le gouvernement devra assumer davantage de responsabilités pour inciter les entreprises à réaliser des objectifs jugés bénéfiques pour l'ensemble de l'économie du pays.
Il ne s'agit donc pas d'imiter l'étatisme qui permet à certains gouvernements européens de tenir fermement les leviers de certaines entreprises privées. Mais ce n'est qu'une question de degré. Le plan de sauvetage des trois grands constructeurs automobiles de Detroit était essentiellement une mesure protectionniste prise aux dépens des fabricants étrangers, et elle n'est pas sans rappeler la décision très controversée, prise en 2004 par Nicolas Sarkozy alors qu'il était ministre des Finances, pour protéger les intérêts du géant Alstom. Stephen Roach, économiste en chef de Morgan Stanley, explique qu'une récession prolongée ne pourra que renforcer "l'intervention de l'Etat dans l'économie", notamment sous la forme du protectionnisme. "Mais l'Amérique n'est pas la France, ajoute-t-il. Nous ferons ça à notre manière – mais, quoi qu'il arrive, le gouvernement fort est de retour."
(...)
Michael Freedman et Tracy McNicoll
Newsweek
lundi 9 février 2009
ÉTATS-UNIS • Les grands vins jugés au pif
Chaque année, les plus grands connaisseurs de vin de Californie se réunissent pour rendre leur verdict. Mais des études montrent qu'ils se trompent… aveuglément, comme s'en amuse Der Spiegel.
Lors de la California State Fair, œnologues, critiques, vignerons et autres spécialistes s'attellent à une tâche herculéenne : goûter pas moins d'un millier de crus, rouges et blancs. Ils évaluent le bouquet du vin pendant les quelques instants suivant le premier contact, avant de le recracher. Puis ils décernent les médailles.
C'est l'heure de vérité du plus vieux concours de vins d'Amérique du nord. Emporter une médaille d'or signifie aussi décrocher un joli magot, car les acheteurs se fient au jugement des dégustateurs de vin. Mais pourquoi, au fait ?
Le chercheur californien Robert Hodgson vient de réaliser la première étude sur les compétences des dégustateurs qui jugent nos vins. Lors d'une dégustation à l'aveugle, il a servi le même produit à trois reprises, à différents moments. Publiés voici peu dans le Journal of Wine Economics, les résultats montrent ceci : rares sont les dégustateurs qui se sont aperçus de la ruse. Pis : leurs appréciations varient énormément.
Seuls 10 % des juges ont donné une appréciation similaire chacune des deux fois où ils ont goûté le même produit. Les autres lui ont attribué une évaluation tantôt meilleure, tantôt moins bonne, en fonction de l'humeur du moment, semble-t-il. Les plus mauvais sujets, au total 10 % des juges, paraissent avoir tout bonnement jugé au pif : après avoir déclaré qu'une bouteille méritait la médaille d'or, ils l'ont qualifiée de médiocre lors de la seconde dégustation.
L'attribution d'une médaille dépend donc avant tout du hasard, non de la qualité du vin. Telle est la conclusion publiée par Robert Hodgson. La réaction des organisateurs de la California State Fair ne s'est pas fait attendre.
Les goûteurs jugés incompétents seront éconduits, tandis que les autres devront prendre soin de leurs papilles gustatives ; désormais, ils ne goûteront pas plus de 75 vins par jour, contre 150 jusqu'à présent. Mais rien ne prouve que leurs jugements en seront plus justes. Car les êtres humains n'ont simplement pas les qualités requises pour établir avec fiabilité ce type de jugement, pas même les "experts".
Les dégustations à l'aveugle sont un exercice de haute voltige. Seule constante, leurs résultats souvent dégrisants !
Il y a deux ans, les grands jurés de R. Hodgson ont couronné un cru distribué par Trader Joe's, le cousin américain de Leader Price, comme le meilleur chardonnay de Californie. Cette bouteille de piquette industrielle à 2 dollars leur est apparue maintes fois plus délicate que ses rivales de la vallée de Napa…
Même les spécialistes les plus chevronnés se trompent souvent de façon grossière lors des tâches basiques de la dégustation à l'aveugle – ce qui pousse les critiques à qualifier ce travail de masochiste. Privés de la vue, les goûteurs ne parviennent pas toujours à distinguer les différents cépages et confondent allègrement un cabernet sauvignon avec un merlot. Qui plus est, rares sont les vignerons qui savent reconnaître leur propre produit parmi une sélection de crus similaires. Le chercheur français Gil Morrot a servi à 54 spécialistes de bordeaux du vin blanc traîtreusement coloré en rouge. Lors de l'examen olfactif, aucun n'a remarqué la tromperie.
Juger un vin est une affaire fort complexe, où les arômes ne jouent souvent qu'un rôle secondaire. Une équipe de psychologues de Mayence a récemment montré que même la couleur de la lumière ambiante pouvait être déterminante. Au final, rien n'est aussi important que le prix. Plus un vin est cher, meilleur apparaîtra son bouquet. Et ce sont justement les spécialistes qui risquent de juger sur l'étiquette. Un vin moyen dans une bouteille hors de prix peut leur sembler divin, tout simplement parce qu'un nom prestigieux, comme Château Petrus, les émoustille à tel point que le vin n'a plus à les convaincre. De même, les formules suggestives telles que "Grand Cru classé" améliorent considérablement la "qualité" d'un produit.
Lors de son étude, R. Hodgson a observé les performances des dégustateurs durant quatre années et constaté ceci : rien n'empêche le meilleur juge d'une année de faire chou blanc l'année suivante. Et si les mauvais goûteurs de vin sont légion, les bons goûteurs n'existent pas.
Lors de la California State Fair, œnologues, critiques, vignerons et autres spécialistes s'attellent à une tâche herculéenne : goûter pas moins d'un millier de crus, rouges et blancs. Ils évaluent le bouquet du vin pendant les quelques instants suivant le premier contact, avant de le recracher. Puis ils décernent les médailles.
C'est l'heure de vérité du plus vieux concours de vins d'Amérique du nord. Emporter une médaille d'or signifie aussi décrocher un joli magot, car les acheteurs se fient au jugement des dégustateurs de vin. Mais pourquoi, au fait ?
Le chercheur californien Robert Hodgson vient de réaliser la première étude sur les compétences des dégustateurs qui jugent nos vins. Lors d'une dégustation à l'aveugle, il a servi le même produit à trois reprises, à différents moments. Publiés voici peu dans le Journal of Wine Economics, les résultats montrent ceci : rares sont les dégustateurs qui se sont aperçus de la ruse. Pis : leurs appréciations varient énormément.
Seuls 10 % des juges ont donné une appréciation similaire chacune des deux fois où ils ont goûté le même produit. Les autres lui ont attribué une évaluation tantôt meilleure, tantôt moins bonne, en fonction de l'humeur du moment, semble-t-il. Les plus mauvais sujets, au total 10 % des juges, paraissent avoir tout bonnement jugé au pif : après avoir déclaré qu'une bouteille méritait la médaille d'or, ils l'ont qualifiée de médiocre lors de la seconde dégustation.
L'attribution d'une médaille dépend donc avant tout du hasard, non de la qualité du vin. Telle est la conclusion publiée par Robert Hodgson. La réaction des organisateurs de la California State Fair ne s'est pas fait attendre.
Les goûteurs jugés incompétents seront éconduits, tandis que les autres devront prendre soin de leurs papilles gustatives ; désormais, ils ne goûteront pas plus de 75 vins par jour, contre 150 jusqu'à présent. Mais rien ne prouve que leurs jugements en seront plus justes. Car les êtres humains n'ont simplement pas les qualités requises pour établir avec fiabilité ce type de jugement, pas même les "experts".
Les dégustations à l'aveugle sont un exercice de haute voltige. Seule constante, leurs résultats souvent dégrisants !
Il y a deux ans, les grands jurés de R. Hodgson ont couronné un cru distribué par Trader Joe's, le cousin américain de Leader Price, comme le meilleur chardonnay de Californie. Cette bouteille de piquette industrielle à 2 dollars leur est apparue maintes fois plus délicate que ses rivales de la vallée de Napa…
Même les spécialistes les plus chevronnés se trompent souvent de façon grossière lors des tâches basiques de la dégustation à l'aveugle – ce qui pousse les critiques à qualifier ce travail de masochiste. Privés de la vue, les goûteurs ne parviennent pas toujours à distinguer les différents cépages et confondent allègrement un cabernet sauvignon avec un merlot. Qui plus est, rares sont les vignerons qui savent reconnaître leur propre produit parmi une sélection de crus similaires. Le chercheur français Gil Morrot a servi à 54 spécialistes de bordeaux du vin blanc traîtreusement coloré en rouge. Lors de l'examen olfactif, aucun n'a remarqué la tromperie.
Juger un vin est une affaire fort complexe, où les arômes ne jouent souvent qu'un rôle secondaire. Une équipe de psychologues de Mayence a récemment montré que même la couleur de la lumière ambiante pouvait être déterminante. Au final, rien n'est aussi important que le prix. Plus un vin est cher, meilleur apparaîtra son bouquet. Et ce sont justement les spécialistes qui risquent de juger sur l'étiquette. Un vin moyen dans une bouteille hors de prix peut leur sembler divin, tout simplement parce qu'un nom prestigieux, comme Château Petrus, les émoustille à tel point que le vin n'a plus à les convaincre. De même, les formules suggestives telles que "Grand Cru classé" améliorent considérablement la "qualité" d'un produit.
Lors de son étude, R. Hodgson a observé les performances des dégustateurs durant quatre années et constaté ceci : rien n'empêche le meilleur juge d'une année de faire chou blanc l'année suivante. Et si les mauvais goûteurs de vin sont légion, les bons goûteurs n'existent pas.
jeudi 5 février 2009
Taken

Luc Besson, lui-même, n'en revient pas : Taken , le film qu'il a produit et co-écrit avec Robert Mark Kamen, s'est installé en tête du box-office américain avec 24,6 millions de dollars de recettes à l'issue du premier week-end. C'est la troisième fois en dix ans que Luc Besson parvient à se hisser au sommet des entrées en Amérique après Le Cinquième Élément et Transporteur 2 . Il n'y a pas d'autres exemples français. "J'ai reçu une quarantaine de messages de félicitations en provenance des États-Unis, a confié Luc Besson au point.fr. Pas un seul de France."
Car Taken, bien que tourné en anglais avec un acteur irlandais (Liam Neeson), est un film tout ce qu'il y a de plus français : le tournage a eu lieu à Paris, avec des techniciens français et de l'argent français. En l'occurrence, c'est M6 qui a acquis la première diffusion du film pour 1,3 million d'euros hors taxes. Canal+ a investi, pour sa part, 2,2 millions d'euros. "Ce qui a touché les gens, ce n'est ni l'acteur, ni la virtuosité du scénario, c'est l'histoire : un homme prêt à tout pour retrouver sa fille enlevée par un gang", a souligné Luc Besson.
Aux États-Unis, Taken réalise également le deuxième meilleur score d'ouverture de tous les temps pour un week-end de Superbowl, et le meilleur démarrage jamais réalisé par un film français pour son premier week-end d'exploitation aux USA. En France, le film, sorti il y a 11 mois, avait enregistré plus de 1 million d'entrées en salle. Taken a depuis été distribué dans 43 autres territoires en 2008 : 69 millions de dollars de recettes à ce jour.
http://www.lepoint.fr/actualites-medias/luc-besson-numero-1-au-box-office-americain-avec-taken/1253/0/313169
Inscription à :
Articles (Atom)